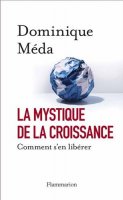Objectif du livre présenté dans l’introduction : « dénouer les liens historiques et idéologiques ...entre croissance, progrès et démocratie » et pour cela « comprendre les multiples rôles que la croissance a joué dans la structuration et le fonctionnement de notre société » ; afin de « se libérer de sa mystique, évacuer le mythe de l’illimité, reprendre la main sur ce processus incontrôlé ». Il s’agira alors de « reconstruire une cause commune…qui tienne ensemble la question écologique et la question sociale », de dépasser néolibéralisme et keynésianisme, d’essayer de changer par une démocratie plus active et non par une « tyrannie bienveillante » ou des conflits meurtriers.
Dans la partie COMPRENDRE, D.Méda insiste d’abord sur la réalité des informations sur l’évolution climatique due à l’activité humaine. Elle n’évacue pas les questions mais avance pas à pas. Ensuite elle cherche les raisons de notre focalisation sur la production, et fait grand place – à la suite du médiéviste Lynn Jr. White - au rôle du christianisme dans l’émergence d’un rapport d’exploitation et de domination de la nature. « Il légitimerait ainsi le mépris dans lequel sera peu à peu tenue la nature à l’époque moderne ». Elle insiste enfin sur la production comme cœur de la fabrique du lien social dans l’histoire du monde industriel. Et montre comment la focalisation sur l’enrichissement individuel et collectif a négligé la nature qui subissait nos prélèvements. La nature est sans voix, négligé par l’économie et la sociologie jusque dans les années 70.
Elle propose enfin un chapitre très éclairant sur le PIB. On sait que cette mesure est une convention qui occulte les dégâts de la croissance, qui ne prend pas en compte des activités non marchandes essentielles au bien-être individuel et social, qui n’est pas affecté par les inégalités dans le travail et dans la consommation. Elle insiste surtout qu’en parlant de flux, notre comptabilité nationale évacue la question du patrimoine (naturel, social, de santé) dans lequel nous puisons pour réaliser cette valeur ajoutée ( ?) que constitue le PIB. Le PIB comme indicateur de croissance « nous pousse dans le mur, il nous rend aveugle, il nous trompe. »
Dans la partie CHANGER, D. Méda discute d’abord la manière dont cherchent à se construire de nouveaux indicateurs, avec souvent une domination encore de la seule économie, de l’utilitarisme. Elle pose la question : « De quoi est composée cette nature que nous voudrions transmettre ? ». Elle propose avec Baird Callicot d’admettre que si les êtres humains sont bien la source de toute valeur, ils « sont capables de valoriser la nature pour elle-même et non pour leur intérêt propre ». Après avoir discuté plusieurs approches elle appelle à « déterminer ce que nous devons transférer aux générations suivantes ». Plutôt qu’un capital, instrumentalisable, un patrimoine naturel dont des éléments devraient être intouchables, dont la qualité ne devrait pas diminuer, et être considérés comme « biens communs ». Mais changer de direction, construire une « prospérité sans croissance » (Jackson), satisfaire les besoins en prenant en considération les limites de la nature et la cohésion sociale, cela demande une reconversion radicale. Et la construction de nouvelles règles.
Dans la partie METTRE EN ŒUVRE, D. Méda rappelle d’abord la manière dont l’Etat a été conduit à fixer des règles dans les relations entre travailleurs et employeurs, à l’issue de luttes multiples et complexes. Mais aujourd’hui qui peut porter la cause de l’écologie quand la pauvreté d’une parti du monde est mise en avant, quand la « crise » a fait reculer les préoccupations écologiques ? Elle montre bien que « les plus pauvres savent parfaitement qu’ils sont ou seront les premiers concernés par l’aggravation de la crise écologique ».
Avec la Confédération Européenne des Syndicats elle propose de l’idée d’une « transition juste » afin de constituer une synthèse entre cause de l’emploi et cause écologique. Elle préconise réduction du temps de travail et ralentissement des gains de productivité dans certains secteurs, mais aussi arrêt de la financiarisation de l’économie et établissement de normes sociales et environnementales, au moins au niveau européen. Pour réaliser cette transition elle plaide pour de puissants mécanismes de sécurisation des travailleurs et une orientation vers une certaine autosuffisance.
Au-delà d’un chapitre sur la justice, elle cherche les fondements d’une éthique et politique visant à respecter la nature, elle montre l’intérêt et les limites actuelles du care ou des notions de vulnérabilité du monde. Et elle pointe que « la politique publique doit définir les critères essentiels du prendre soin que l’activité de production devra respecter ». Elle souligne aussi qu’une nouvelle science, un nouveau langage doit se construire pour dessiner les contours du monde que nous voulons.
Comment mobiliser nos contemporains, comment lutter contre les inégalités, comment sortir de l’addiction à la consommation des individus et des institutions ? Faut-il prendre appui sur la notion de bien-être, de bonheur, toujours ambigüe ? Insister plutôt sur la justice et le caractère collectif des questions et des solutions, sur le développement du régime associationniste dans l’économie ? D.Méda conclue en rappelant les idéaux et les valeurs du monde grec : le sens de la mesure, de la limite, la capacité à imiter la nature, à respecter ses rythmes, à faire de l’autarcie une valeur, à produire au plus juste (sans ses défauts connus).
L’ouvrage est plein de questions, au sens positif du terme : il complexifie les situations, non pas pour les rendre inextricables mais pour en montrer les enjeux. Il cite précisément les sources de la réflexion : cela peut paraitre universitaire, mais c’est aussi une forme de partage heureux des ressources disponibles.
Bien sûr on attendrait plus de « solutions », plus de certitudes sur les luttes à mener, plus d’éclairage sur ce qui -déjà aujourd’hui- trace un chemin, mais ce n’est pas l’objet du livre.
Enfin une remarque sur la dimension critique du christianisme. Il ne s’agit pas d’exempter les sociétés imprégnées de christianisme de leur rôle dans le développement d’une production prédatrice. Mais le christianisme en est-il la cause « en dernière instance » ? J’ai encore du mal à le croire.
Quand à l’emploi de « mystique » dans « Mystique de la croissance », j’espère qu’il s’agit d’un choix de l’éditeur. Qu’il y ait une « religion de la croissance », sans doute. Une mystique – pour reprendre Max Weber cher à l’auteur- contemple le monde plus qu’elle ne le transforme.