Ce documentnous rappelle que la multiplicité des crises qui nous menace et atteint déjà de nombreux peuples doit nous inciter a désirer une église résistante, confessante et persévérante dans la lutte contre toutes les dominations et par ailleurs toujours en alerte pour promouvoir la justice, la paix, la dignité et la liberté pour toutes et tous.
Le document évoqué et énumère toutes les crises en cours, en analyse les causes, les confronte au texte biblique, à notre tradition théologique calviniste, ainsi qu’à toutes les théologies de la libération émergées ces dernières décennies.
Rien n’est laissé de côté, la crise climatique, la disparition de la biodiversité, l’obscénité des inégalités, le regard porté sur nos frères "d ailleurs" , les politiques autoritaires et sécuritaires, les méfaits du capitalisme, la renaissance des empires belliqueux, et de plus la domination sur les femmes et l’exploitation des enfants au travail.
Le document transmis est composé de 5 chapitres, sur le même modèle :
une introduction, un développement, des questions a débattre en groupe et a transmettre au secrétariat de la communion.
Les trois premiers chapitres sont en quelque sorte stratégiques.
Le premier "favoriser une communion juste ". Dans un monde dominé par l’ambition des empires et leurs affidés, de dépouiller les peuples fragiles afin de s’assurer une sécurité et un confort indécent, il est indispensable de dénoncer la souveraineté mortifère du capitalisme, c est a dire la domination de l argent .
Le deuxième chapitre : s engager pour la justice". Si l on a qualifié notre ère actuelle d ’ "anthropocène", il vaut mieux aujourd’hui la qualifier de "capitalocene", car toute l humanité ne contribue pas de la même manière au désastre imminent.
Il est évident que la possession par les uns pour cent les plus riches de la moitié des richesses produites doit être dénoncée publiquement, fortement. Nos églises doivent s engager avec détermination sur ce chemin qui n’est que la prolongation du Magnificat de Marie. Tout en dénonçant, ce scandale elles doivent inaugurer des lieux de vie véritable qui de marges fécondes deviennent des " communs" partagés.
Le troisième chapitre : une théologie pour un monde blessé ! Informée par la lecture des prophètes du premier testament, nourrie par la tradition calviniste, confortée par les théologies de toutes les libérations, cette théologie tout en disqualifiant les lectures fondamentalistes qui détournent le sola scriptura peut et doit contextualiser sa démarche et ainsi fournir a une église célébrante les outils d une insurrection pacifique mais déterminée et persévérante afin que de sa liturgie, surgisse un envoi pour qu’une diaconie confessante, résistante, libératrice de tous les esclavages, dans ce monde blessé se mette en œuvre.
En conclusion ce document préconise l approfondissement d une théologie des "marges ", " hors les murs ," pour que l’église découvre sans cesse que son centre est toujours a sa périphérie et que lutte et contemplation se fécondent mutuellement pour que le royaume de Jésus Christ soit sans cesse révélé.
Jean-Pierre Rive.
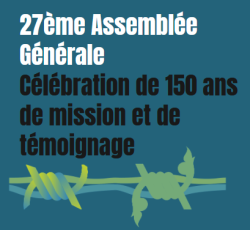
Je partage cette vision du document dont la force est rare dans un document d’église.
(le chiffres renvoient soit aux page - p. - du document soit aux numéro des paragraphes)
Il est dommage que les très intéressants concepts de Sumud (perséverer en arabe palestinien) et Shalom (paix communautaire) présentés dans la préface ne se retrouvent pas comme des fils rouges dans la suite du document.
L’idée que (p. 3) : « sans persévérance, sans Sumud, il ne peut y avoir de véritable construction communautaire de la paix - Shalom » est particulièrement forte et gagnerait à être reprise par la suite.
D’autres remarques apparaissent dans le détail des propositions d’amendement ci-dessous.
– Les « signes de communauté persistante/résistante, de recommunion et de contre-solidarités » qui mériteraient de se retrouver reprise dans la partie témoignage,
– La tendance à oublier les personnes LGBTQIA+ alors que le texte mentionne la lutte contre l’hétero-normativité, la justice de genre et la violence homophobe.
– L’interrogation sur le fait qu’on puisse citer le génocide à Gaza en omettant le pogrom du 7 octobre. Cela semble difficile dans l’absolu et a fortiori en France qui s’enorgueillit d’avoir la plus grande communauté juive d’Europe dont nous sommes solidaires et le seront encore plus quand l’extrême droite sera au pouvoir.
– Il est heureux que soit évoqué que « de nombreux peuples indigènes conçoivent la communion comme holistique, incluant les humains, la nature, les esprits et les animaux » mais dommage que soit oublié que cette vision existe aussi dans une théologie chrétienne orthodoxe ou pré-moderne qui est aussi notre patrimoine : François d’Assises, Brigitte d’Irlande, Pères du désert, ermites jusqu’aux XIIIe siècle…
– La notion de « contre-souveraineté du Christ » est forte et en même temps à manipuler avec précaution. Sans le « contre », la notion de « règne social du Christ » est utilisée en France par les courants catholiques intégristes d’extrême droite pour justifier un pouvoir réactionnaire royaliste et catholique. Elle ne peut pas être employé autrement que comme une notion critique des souverainetés, à la limite comme analogie (cf Barth) mais pas pleine.
– Quand le document évoque « Le péché du colonialisme... », « un péché qui reste impénitent et non réparé... », quelle vision du péché cela induit-il ? Sans doute par démarcation avec le catholicisme, le protestantisme français à du mal voir le péché comme attaché à des actes en particulier (aucun acte n’est essentiellement pécheur) mais un comme un état général d’incomplétude et de « ratage » de la cible. Le colonialisme est bien sûr un cas limite, il n’y a pas de « bon » colonialisme. De plus il y a un piège : en protestantisme nous sommes « en même temps pécheur et justifié ». Or le texte insiste sur le caractère « impénitent et non réparé » du colonialisme ».
– Il y a une attaque en règle contre la théologie de l’intendance en matière d’écologie, qui correspond à l’abus qu’en ont fait les pouvoir Etats-Uniens avec la notion de « stewardship » qui a dérivé vers un quasi « pilotage » de la planète. Mais dans les années 70 (cf COE Bucarest 1974) la théologie de l’intendance a été un progrès dans la vision écologique de la théologie occidentale. Si elle profondément paternaliste et véhicule une vision dualiste et naturaliste (l’homme et son « environnement »), elle continue à avoir une certaine efficacité dans les communautés locales pour appeler chacun à ses responsabilité devant Dieu pour respecter sa création. Peut-être faut-il être moins sévère avec elle ?
– La notion d’Empire me semble particulièrement riche mais ne faut-il pas aujourd’hui parler d’Empires au pluriel car comme il y avait des empires coloniaux, il y a les États-Unis mais aussi, la Chine, la Russie, les Gafam, les multinationales : ils sont animé d’une logique impériale à la fois identique et concurrente. Empire au singulier désignerait alors cette logique commune.
– N’y-a-t-il pas une complaisance pour Cuba (le Vénézuela ? La Corée du Nord ?), les régimes militaires du Mali, du Burkina Faso, du Tchad… dans les passages sur : « dans le même temps, les sanctions contre les nations qui ne suivent pas la ligne du capitalisme néolibéral plongent dans la
pauvreté une grande partie de leurs populations et les privent de ressources indispensables, y compris de médicaments vitaux » (12), la mention de « nouveaux mouvements démocratiques qui émergent de la base et remettent en question les systèmes soutenus par les puissances impériales » (23)
Stéphane Lavignotte

